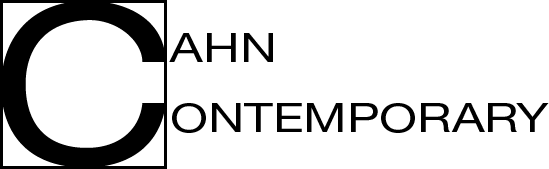Please scroll down for the French version
Cécilia Becanovic: I’m thinking of mains amies [friendly hands], the first part of a collaborative project between Marcelle Alix and Cahn Contemporary, which is continuing today in the various spaces of a private residence in Bagnolet. Our approach, at the time, indulged in a poetic reverie, leading us to handle age-old objects fatally inaccessible in museums. In hindsight, last year’s exhibition was an adventure with spiritism overtones, between the ectoplasmic presence of Ian Kiaer’s inflatable sculpture and Laura Lamiel’s painting on glass mimicking the depths of a material similar to the greenish patina of the Roman helmet simply placed in front of it. Not to mention the video by Charlotte Moth, whose imagination finds its own impetus until the moment when the sculptures from a storeroom take over and start talking to each other. Only Louise Hervé & Clovis Maillet appeared to have lent their bodies so that pre-historic tools could find, once again, the shape of a hand, the position of a body accustomed to using them. The duo highlighted the physical need to bear an object and to let it get hold of us so as to understand its function. parti·e·s hier [gone yesterday] tells the story of a body that is inseparable from the surrounding objects. The object knows how to await the return of the person responsible for continuing to use it. This interconnectedness was subject to debate within the studios of the artists whom we invited for this second part. If perfection, symmetry, verticality and control don’t or no longer dominate, what does? What draws a connection between the social mindset of the ancient Greek and Roman society and the way in which Jean-Charles de Quillacq puts the body in various states, without moderation nor codification? Can one speak of a renaissance when one digs an object out of the ground and endows it with an almost invisible effort, as Gyan Panchal so patiently does?
Manon Burg: What you’re describing about the practice of Jean-Charles de Quillacq, driven by desire, and about his relationship to the body, reminds me of a conversation we had together with Jean-David Cahn in Basel, last summer. Jean-David was explaining to us, based on a vase representing a homoerotic scene, that during archaic and classical Greece, homosexuality was — beyond being socially accepted and agreed upon — a rite of passage that was essential to men’s civic education in the city. Teenagers (called eromenos, translated as beloved) then developed an affective and sexual relationship with adults (erastes, translated as lovers), before commonly adopting a form of heterosexual sociability, following the equivalent of the military service, which marked the beginning of adulthood. Then, in due time, former eromenos became erastes, in turn having relationships with young ephebes. Based on these comments around the homosocialisation of the male Athenian elite, other thoughts emerged about the Western construction of “beauty”, the cult of the athletic and able-bodied male individual, thus leading to the obvious observation that our phantasmagorical worlds — and by extension, mainstream porn imagination — are still haunted by these bodies. The question that I now have is the following: what do these age-old objects tell about us, what kind of relationship do we develop with them? What do these figures or rather these fragments of figures — these feet, these arms, this clenched fist, this nose — provoke in us? While the historian must, as required by the field, adopt a selfless and scientific gaze towards objects, that of the artist — here Jean-Charles de Quillacq — happens to be much more organic, libidinal, or even fetishising*… Whereas Gyan Panchal imagines new objects containing, like these artefacts, evidence of a past use, traces of a previous life. He creates a form of echoing, of remembrance, of equivalence, to those already existing, thereby multiplying the latter’s narrative possibilities.
Gyan Panchal: What you were evoking, Cécilia, in a previous email relating to the status of bodies and models asserting a form of stability (of eternity?) in relation to other bodies and objects dealing more with imbalance and instability (naked bodies and objects that are troubled and vulnerable, exposed to the outside world, looking out) — all this is also important to me. Besides the older pieces that I was thinking about (le versant, le témoin [the slope, the witness]), I have to admit that most of the works produced for this exhibition are inevitably echoes, ricochets of pieces that I have seen in Jean-David Cahn’s collection. During a visit in Bagnolet, we talked about the back of artworks, their flip side, their drop shadow. Compared to ancient objects, which I relate to wars, conflicts, wrecks, looting, as well as trade, the objects that I propose in a dialogue speak perhaps, through their forms as containers, of fecundity, gestation, fear, theft, and predation. In the most silent possible way — I hope. And there is something else, related to time, which comes to mind, a comment shared with colleagues about a workshop we are organising together: in one of her texts, sci-fi writer Ursula K. Le Guin offers to consider other kinds of narration than that of the (deadly) arrow of linear time. The form that she suggests in contrast — assuming that it was one of the first cultural inventions — is a flask, a shell, a net, a bag, a baby carrier, a satchel, a bottle, a tank, a vessel, a container. The reference to this container form appeals to me very much. I don’t know why, but I make a lot of containers. Sometimes empty, sometimes inhabited.
Isabelle Alfonsi: I’m picking up on this idea of containers. Just as we are launching the second edition of our common project in Bagnolet, this house — an old factory — appears to me as the container of all containers. It is the stage where, every year, are expressed a set of fantasies and representations that the artists project onto ancient objects which seem less and less distant from us, in so far as the proximity established between them by Jean-David Cahn proves to be effective. I have in mind Laura Lamiel’s intervention last year, who found it just as timely to gather in the office a Greek bronze helmet next to a glass painting and Chinese ink drawings, on an equal footing with a watering can found in the garden. This “domestic” setting — which we are particularly fond of at the gallery — urges us to pay careful attention to every detail, and to consider each object for both its functional aspect and as if it were potentially an artwork. I’ve always loved visiting the homes of artists and writers for that very reason: the daily equivalence which is reconstituted between the artworks, the manuscripts, the everyday objects that have been left there, as if their owner had left yesterday, to quote the title of this exhibition. I believe that what we are trying to show through this project is what an approach in terms of historicity can bring to our understanding of art. This is what Aurélien Froment was already addressing last year with the film Allegro Largo Triste (2017), by describing an age-old Sardinian practice involving the production and the use of a polyphonic flute. This is the opposite of a backward-looking or conservative vision of art. On the contrary, it make us much stronger in the present to feel this past behind us, as support, a solid basis.
Jean-David Cahn: Archaeologists and historians follow several methods in order to extract a maximum of information allowing them to restore the habits and the history of a past society in relation to the objects of study. These archaeological objects that have reached us stem from the chance of today’s finds, as well as from that of loss, of burial rites, of the deliberate or involuntary destructions from the past. They enable us to interpret their content, the evolution of a style, as well as, ideally, their environment. They are the messengers of a fragmented past that we are attempting to decipher. While the archaeologist’s approach lays claim to objectivity, there is nonetheless a subjective dimension for this objectivity reflects the society in which the research is produced. Observing how artists respond proves to be of greater interest, since they communicate the present through their abilities and their sensitivity. Their approach is certainly subjective and emancipatedfrom the framework imposed by academic rigour. It is more direct, and without filters. Not the framework of the past, but one that is fragmented, consisting of our current society. It is fascinating to witness this approach stripped of all the museography that is imposed by the dictates of public exhibitions displaying archaeology. Our perspective has shifted by exhibiting objects in a contemporary environment. This other way of looking affects us more directly. It is wonderful to exchange in the rather intimate space of an old medal factory, to offer this experience within the context of an “experimental” gallery, as part of a collaboration between an archaeologist, contemporary artists and gallerists.
*And yet, the boundary between the rigour required by the field and the fetishistic tendency can sometimes be porous: with J. J. Winckelmann (1717-1768) — the first Greek art specialist, the “founder” of Art History considered as a science —, the desire for knowledge and sexual desire are interwoven. See Whitney Davis,“Winckelmann Divided: Mourning the Death of Art History”, Journal of Homosexuality, The Haworth Press, Inc., 1994, pp 141-160
Cecilia Becanovic : Je repense à mains amies, le premier volet d’une collaboration entre Marcelle Alix et Cahn Contemporary qui se poursuit aujourd’hui dans les différents espaces d’une demeure privée à Bagnolet. Notre approche, à ce moment-là, s’abandonnait à une rêverie poétique nous amenant à manipuler des objets millénaires fatalement inaccessibles dans les musées. Avec le recul, l’exposition de l’année dernière était une aventure aux accents spirites, entre la présence ectoplasmique de la sculpture gonflable de Ian Kiaer et la peinture sur verre de Laura Lamiel mimant les profondeurs d’une matière proche de la patine verdâtre du casque d’origine romaine simplement posé devant. Sans oublier la vidéo de Charlotte Moth dont l’imagination trouve son propre élan jusqu’au moment où les sculptures d’une réserve prennent le relai et se mettent à parler entre elles. Seul·e·s Louise Hervé & Clovis Maillet semblaient avoir prêté leurs corps pour que des outils de la préhistoire retrouvent la forme d’une main, la position d’un corps habitué à s’en servir. Le duo rendait évident ce besoin physique de porter un objet et le laisser nous posséder pour en comprendre la fonction. parti·e·s hier raconte l’histoire d’un corps inséparable des objets qui l’entourent. L’objet sait attendre le retour de la personne chargée de poursuivre son utilisation. Cette interdépendance fait débat au sein des ateliers des artistes que nous avons invité·e·s pour ce deuxième volet. Si la perfection, la symétrie, la verticalité et le contrôle ne dominent pas ou plus, qu’est-ce qui domine ? Qu’est-ce qui fait le lien entre la mentalité sociale de la société gréco-romaine et la manière dont Jean-Charles de Quillacq met le corps dans tous ces états sans modération ni codifications ? Peut-on parler de renaissance lorsque l’on sort un objet de la terre et que l’on place en lui un effort quasi invisible, comme le fait si patiemment Gyan Panchal ?
Manon Burg : Ce que tu décris à propos de la pratique Jean-Charles de Quillacq, motivée par le désir, et de son rapport au corps, me rappelle une conversation que nous avons eue ensemble avec Jean-David Cahn à Bâle l’été dernier. Pour le contexte, Jean-David nous expliquait, à l’appui d’un vase représentant une scène homoérotique que dans la Grèce archaïque et classique l’homosexualité était, au-delà d’être socialement acceptée et convenue, un rite de passage incontournable dans l’éducation civique des hommes de la cité. L’adolescent (appelé éromène, traduit par bien-aimé) entretenait alors une relation affective et sexuelle avec un adulte (éraste, traduit par amant), avant d’adopter généralement une sociabilité hétérosexuelle à la suite de l’équivalent du service militaire, marquant l’entrée dans l’âge d’adulte. Puis en temps voulu, l’ancien éromène devenait l’éraste, ayant à son tour des relations avec un jeune éphèbe. De ces commentaires autour de l’homosocialisation chez l’élite masculine athénienne sont nées d’autres réflexions autour de la construction occidentale du « beau », du culte du corps, athlétique et valide, menant ainsi à l’évident constat qu’aujourd’hui encore nos univers fantasmatiques — et par extension — l’imaginaire du porno mainstream sont hantés par ces corps-là. La question que je me pose à présent est : qu’est-ce que ces objets millénaires disent de nous et quel rapport entretenons-nous avec eux ? Qu’est-ce que ces figures ou plutôt ces fragments de figures, ces pieds, ces bras, ce poing, ce nez éveillent en nous ? Là où l’historien·ne se doit, par la discipline, d’adopter un regard désintéressé et scientifique aux choses, celui de l’artiste, en l’occurrence de Jean-Charles de Quillacq, s’avère être beaucoup plus organique, libidinal, voire fétichisant*… Alors que Gyan Panchal imagine des nouveaux objets contenant, comme ces artefacts, des traces d’un usage passé, celui d’une vie antérieure. Il produit une forme d’écho, de réminiscence, d’équivalence, à ceux déjà existant, multipliant ainsi les potentiels narratifs de ces derniers.
Gyan Panchal : Ce que tu évoquais Cécilia dans un email précédent relatif à la place des corps, des modèles, affirmant une forme de stabilité (d’éternité ?) face à d’autres corps et objets qui parleraient davantage de déséquilibre, d’instabilité (corps et objets dénudés, exposés au dehors, regardant au dehors, troubles, vulnérables) tout ceci est aussi important à mes yeux. Hormis des pièces antérieures auxquelles je pensais (le versant, le témoin) je dois avouer que la plupart des pièces réalisées pour cette exposition sont forcément des échos, des ricochets des pièces que j’ai pu voir dans la collection de Jean-David Cahn. Lors d’une visite à Bagnolet, nous avons parlé du dos des œuvres, de leur revers, leur ombre portée. Par rapport à des objets antiques qui me parlent de guerres, de conflits, de naufrages, de pillages, de commerces également, les objets que je propose en regard parlent peut-être, depuis leurs formes de contenants, de fécondité, de gestation, de peur, de vol et de prédation aussi. De la façon la plus muette possible, je l’espère. Et puis il y a autre chose, par rapport au temps, me revient en tête une remarque échangée avec des collègues autour d’un atelier qu’on organise ensemble : l’autrice de science-fiction Ursula K. Le Guin propose, dans un de ses textes, d’envisager d’autres types de narration que ceux de la flèche (mortelle) du temps linéaire. La forme qu’elle y oppose, en supposant qu’elle fut l’une des premières inventions culturelles, est une gourde, une coquille, un filet, un sac, un porte-bébé, une besace, une bouteille, un réservoir, un réceptacle, un récipient. L’évocation de cette forme de contenant me parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je fabrique beaucoup de contenants. Parfois vides, parfois habités.
Isabelle Alfonsi : Je rebondis sur cette idée de contenants. Au moment où s’ouvre cette deuxième édition de notre projet commun à Bagnolet, cette maison, ancienne usine, m’apparaît comme le contenant de tous les contenants. Elle est la scène, chaque année, où s’expriment un ensemble de fantasmes et de représentations que les artistes projettent sur des objets antiques qui nous apparaissent de moins en moins éloignés de nous, tant la proximité que Jean-David Cahn organise entre eux s’avère effective. Je pense à l’intervention de Laura Lamiel l’année dernière qui avait trouvé tout aussi opportun de rassembler dans le bureau un casque grec en bronze en regard d’une peinture sous-verre et de dessins à l’encre de chine, au même titre qu’un arrosoir trouvé dans le jardin. Ce contexte “domestique”–que nous affectionnons particulièrement à la galerie–impose une attention minutieuse à tous les détails, la considération de chaque objet à la fois pour son aspect utilitaire et comme s’il était potentiellement une œuvre d’art. J’ai toujours adoré visiter les maisons particulières d’artistes ou d’auteur·rice·s, pour cette même raison : l’équivalence quotidienne reconstituée entre œuvres, manuscrits, objets du quotidien laissés là comme si leur propriétaire était parti·e hier, pour reprendre le titre de cette exposition. Je crois que ce que nous cherchons à montrer à travers ce projet c’est ce qu’une approche en terme d’historicité apporte à notre lecture de l’art. Plus nous nous inscrivons en dialogue avec le passé et plus nous nous sentons porté·e·s dans le présent. C’était déjà ce qu’Aurélien Froment abordait l’année dernière dans le film Allegro Largo Triste (2017) en décrivant une pratique sarde millénaire autour de la fabrication et de l’usage d’une flûte polyphonique. C’est l’inverse d’une vision passéiste ou conservatrice de l’art. Au contraire, cela nous rend beaucoup plus fort·e·s au présent de sentir ce passé derrière nous, comme un appui, une base solide.
Jean-David Cahn : L’archéologue et l’historien·ne appliquent plusieurs méthodes dans le but d’extraire un maximum d’informations permettant de reconstruire l’usage et l’histoire d’une société passée en rapport avec les objets étudiés. Ces objets archéologiques parvenus jusqu’à nous sont tant dus au hasard de la trouvaille d’aujourd’hui, qu’à celui de la perte, de rites funéraires, de destructions volontaires ou involontaires d’autrefois. Ils nous permettent d’interpréter aussi bien le contenu, l’évolution d’un style ou encore et idéalement leur environnement. Ce sont les messagers d’un passé fragmenté que nous tentons de déchiffrer. Si l’approche de l’archéologue prétend à l’objectivité, il existe pourtant un élément subjectif car cette objectivité reflète la société dans laquelle la recherche est produite. L’intérêt s’avère plus grand à observer comment réagit l’artiste, lui·elle qui transmet par sa capacité et par sa sensibilité le présent. Son approche est sûrement subjective et libérée du cadre imposé par la rigueur académique. Elle est plus directe, sans filtres. Non celui du passé, mais celui, fragmentaire, composé par notre société d’aujourd’hui. Il est passionnant d’observer cette démarche dépouillée de toute muséographie forcée par les dictats des expositions publiques présentant l’archéologie. Notre perspective a mué, en découvrant les objets dans un milieu contemporain. Cet autre regard nous touche plus directement. Il est passionnant d’échanger dans l’espace plutôt intime d’une ancienne médaillerie, de proposer cette expérience dans le cadre d’une galerie “expérimentale” lors d’une collaboration entre archéologue, artistes et galeristes contemporain·e·s.
*Or, la frontière entre la rigueur de la discipline et la tendance fétichiste peut parfois être poreuse : chez J. J. Winckelmann (1717-1768), premier spécialiste de l’art grec, « fondateur » de l’histoire de l’art conçue comme une science, désir de savoir et désir sexuel s’entremêlent. Cf. Whitney Davis, “Winckelmann Divided: Mourning the Death of Art History”, Journal of Homosexuality, The Haworth Press, Inc., 1994, pp 141-160